À quoi ressemblait une journée dans l’assiette d’un citoyen de la Rome antique ? Les riches banquaient-ils vraiment allongés sur des lits, entourés de plats extravagants ?
Derrière les clichés, l’alimentation romaine révèle des habitudes surprenantes et une organisation bien précise.
Des plats simples aux extravagances des élites, découvrons ensemble ce que mangeaient les Romains au quotidien.
Préparez-vous à un voyage culinaire dans l’Antiquité qui pourrait bien bousculer vos idées reçues !
Quelle était l’alimentation de base du citoyen romain ?
Quels aliments formaient le socle de l’alimentation romaine ? Comment nourrissait-on une population aussi nombreuse sans modernité agricole ?
Loin des fastes des banquets, le quotidien alimentaire des Romains reposait sur quelques piliers simples mais efficaces.
Dans cette section, nous explorerons les aliments de base qui constituaient la majorité des repas ordinaires.
Pain, huile, vin… trois éléments omniprésents dans les cuisines romaines.
Du pain, des légumineuses et des fruits secs
Le pain était au cœur de l’alimentation romaine. Fabriqué à partir d’épeautre ou de blé, il existait sous diverses formes : galettes, pains levés ou plats. Il constituait un aliment de base, souvent accompagné de légumes ou trempé dans de l’huile d’olive pour donner plus de goût. Le pain était parfois préparé à la maison, mais les boulangeries étaient également fréquentes en ville.
Les légumineuses comme les pois chiches, les lentilles ou les fèves figuraient parmi les principales sources de protéines végétales. Faciles à conserver, nourrissantes, elles étaient consommées en purée, en soupes ou dans des plats mijotés. Leur rôle était fondamental pour les classes populaires, mais elles étaient présentes dans tous les foyers.
Les fruits secs, notamment les figues, les raisins secs ou les dattes, complétaient souvent les repas. Riches en sucre naturel, ils étaient prisés pour leur goût sucré et leur capacité à être conservés longtemps. Ces aliments simples offraient aux Romains une alimentation complète et relativement équilibrée.
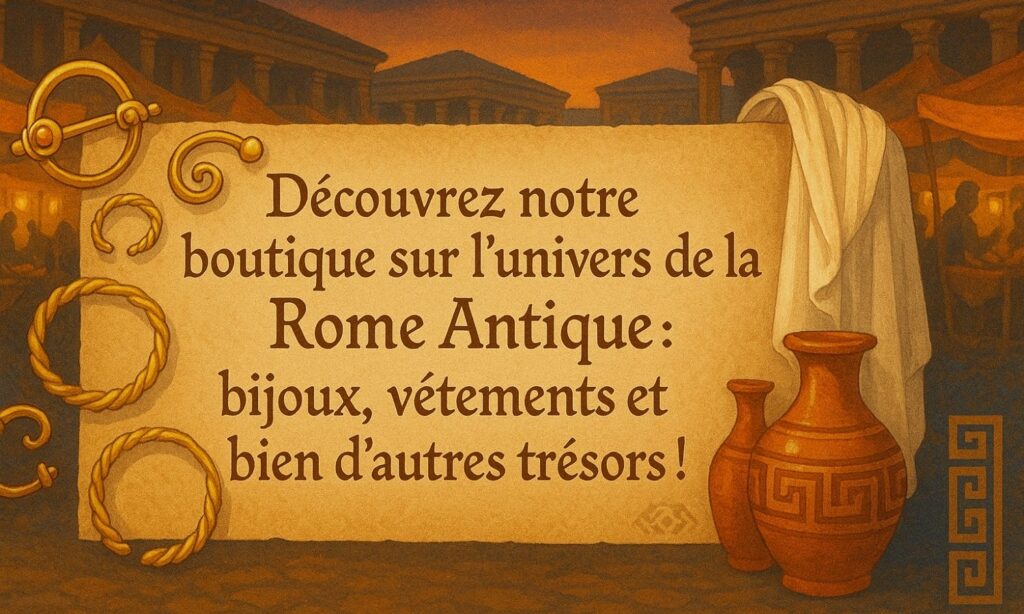
L’huile d’olive comme ingrédient central
L’huile d’olive jouait un rôle central dans la cuisine romaine, bien au-delà de son usage pour la cuisson. Elle servait aussi bien d’assaisonnement que de base pour les sauces, ou encore pour conserver certains aliments. Produite massivement dans tout le bassin méditerranéen, elle était un produit stratégique et un marqueur de civilisation.
Les Romains utilisaient l’huile d’olive dans presque tous les plats, parfois même en grande quantité. Elle accompagnait les légumes bouillis, les poissons ou les céréales, et rehaussait les saveurs avec subtilité. L’huile d’olive de qualité supérieure était très appréciée dans les milieux aisés, mais les classes modestes en consommaient également, bien que de qualité moindre.
Au-delà de l’alimentation, l’huile servait aussi dans les soins du corps et les rituels religieux. Ce produit multifonction illustre l’ingéniosité et la cohérence du mode de vie romain, centré sur des ressources naturelles bien exploitées.
Pour apprendre à cuisiner comme dans la Rome Antique, découvrez notre livre de recettes sur Amazon : livré en quelques jours !
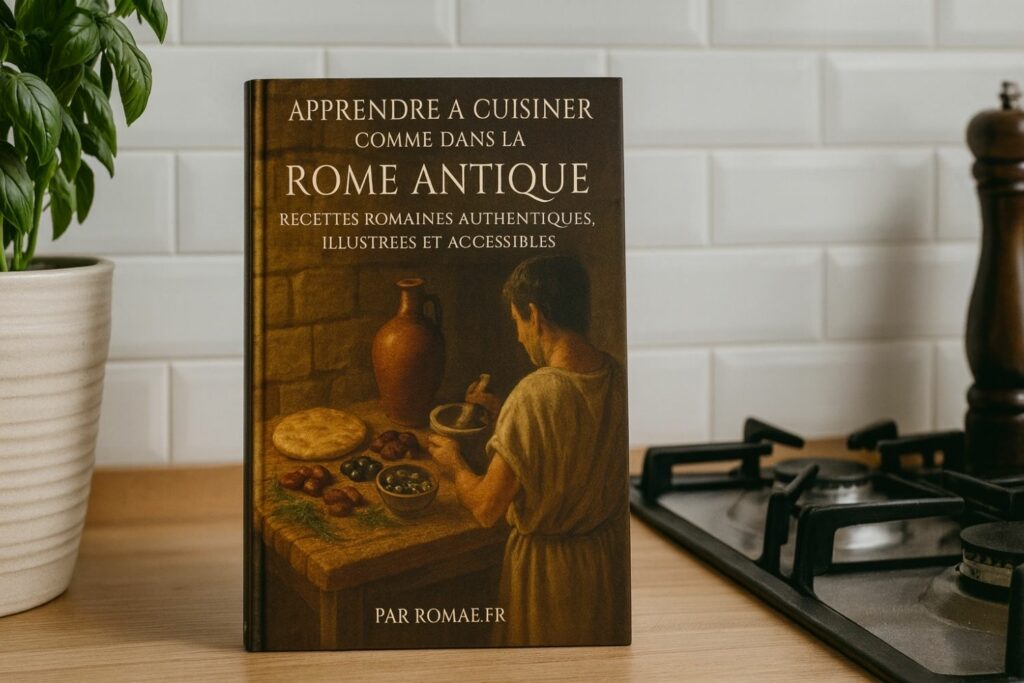
Le vin dilué, boisson quotidienne
Contrairement à nos habitudes modernes, les Romains ne buvaient jamais de vin pur. Il était systématiquement coupé avec de l’eau, parfois agrémenté d’herbes, de miel ou d’épices. Ce mélange permettait de le rendre plus digeste et d’éviter une ivresse trop rapide, tout en désinfectant l’eau, souvent douteuse.
Le vin faisait partie intégrante de chaque repas, quelle que soit la classe sociale. Il existait des vins de qualité variable, des plus grossiers réservés au peuple aux crus raffinés destinés aux élites. Même les esclaves recevaient une ration de vin quotidien, preuve de son importance culturelle.
Boire du vin pur était considéré comme barbare. Cette coutume de dilution montre l’importance du contrôle de soi dans la culture romaine. Le vin, plus qu’une boisson, incarnait un art de vivre modéré et civilisé.
Comment mangeaient les classes populaires ?

Les classes modestes romaines avaient-elles accès à une alimentation variée ? Quels étaient les plats typiques des ouvriers, artisans et petits paysans ?
Dans cette partie, nous découvrirons comment les plus démunis organisaient leurs repas avec peu de moyens.
Vous verrez que créativité et récupération permettaient de cuisiner malgré les contraintes.
Des repas simples, rustiques mais nourrissants : tel était le quotidien culinaire des humbles.
Des repas simples et peu coûteux
Le régime alimentaire des classes populaires était marqué par la simplicité. La priorité était de se nourrir de manière économique et rapide. Les ingrédients provenaient souvent du marché, des distributions publiques ou de leur propre potager pour les ruraux. Peu de transformation, beaucoup de rusticité, mais toujours avec le souci de se rassasier.
Les repas consistaient généralement en un mélange de céréales, de légumineuses, de quelques légumes cuits et d’un morceau de pain. L’eau, parfois additionnée de vinaigre (posca), accompagnait le tout. Ce régime frugal permettait de tenir une journée de travail physique sans se ruiner.
Dans les villes, beaucoup se tournaient vers les thermopolia, sortes de cantines ou tavernes populaires. On y mangeait chaud à moindre coût, souvent sur le pouce, dans des bols en terre cuite. Une alternative utile pour ceux qui n’avaient pas de cuisine chez eux.
Une consommation limitée de viande
La viande était rare pour les classes populaires. Elle coûtait cher et n’était pas toujours facile à se procurer. Le plus souvent, on consommait des abats ou des morceaux délaissés par les riches. Il arrivait que certains bénéficient de dons alimentaires, notamment lors de fêtes religieuses ou de distributions civiques.
Quand ils en avaient les moyens, les modestes se tournaient vers le porc, considéré comme la viande la plus abordable. Le gibier, quant à lui, était inaccessible, et le bœuf ou l’agneau réservés aux grandes occasions. La viande était souvent bouillie ou intégrée à des plats mijotés pour en prolonger l’usage.
Pour compenser, les Romains pauvres consommaient plus de produits végétaux, d’œufs et parfois du poisson salé. La rareté de la viande contribuait à la créativité culinaire, poussant à en extraire le maximum de saveur dans les recettes.
Des restes souvent recyclés dans des ragoûts
Rien ne se perdait dans les cuisines des plus pauvres. Les restes de pain, de légumes, ou de viande étaient récupérés pour composer des ragoûts ou des soupes épaisses. Ces plats, mijotés longtemps à feu doux, permettaient d’attendrir les aliments les plus durs et d’unifier les saveurs.
Un des plats typiques était la puls, sorte de bouillie à base de céréales et d’eau, agrémentée selon les moyens du jour. On y ajoutait parfois des herbes, des légumineuses ou des restes de viande. Ce genre de plat constituait une solution économique et nourrissante.
Ce recyclage systématique témoigne d’une culture du bon sens culinaire. Bien avant le concept moderne de lutte contre le gaspillage, les Romains savaient tirer parti de chaque aliment jusqu’à la dernière miette.
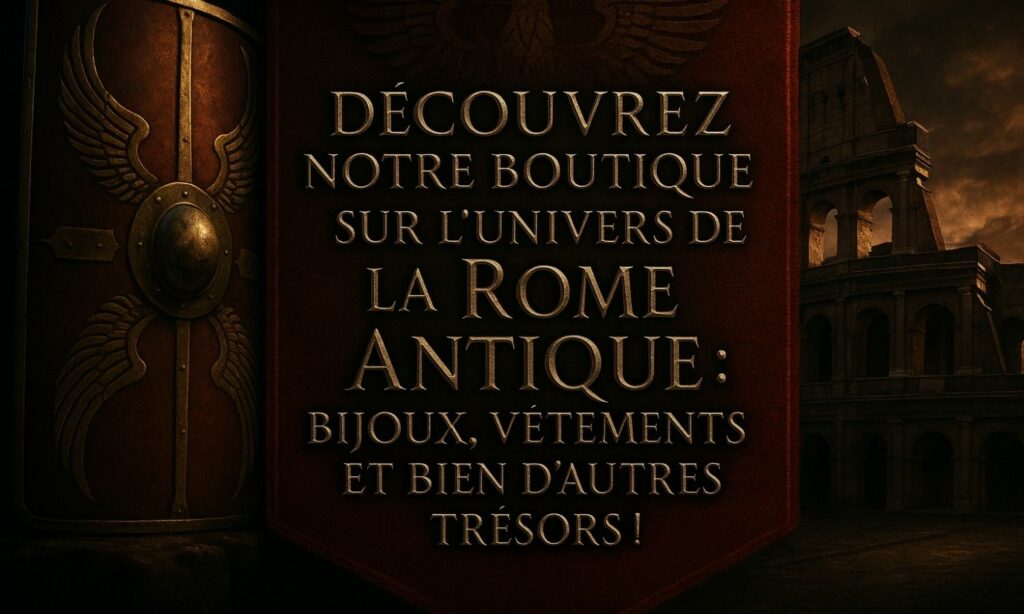
Que consommaient les riches Romains ?
Quels trésors culinaires se cachaient sur les tables des élites romaines ? À quoi ressemblaient leurs festins grandioses ?
Dans cette section, vous découvrirez un contraste saisissant avec la frugalité du peuple.
Les classes aisées cultivaient le goût de l’excès, de la variété et de l’originalité.
Voici un aperçu des mets luxueux qui faisaient vibrer les palais des plus fortunés.
Des mets exotiques et épicés
Les riches Romains raffolaient des produits venus de loin. Les épices, importées d’Orient, permettaient de relever les plats avec originalité. Le poivre, la cannelle ou le gingembre figuraient parmi les plus prisées, tout comme les dattes de Syrie ou les huîtres de Bretagne.
La rareté faisait le prestige. Certains aliments exotiques servaient à démontrer sa richesse et son raffinement. On dégustait des langues de flamants, des paons rôtis, ou encore des loirs farcis. Le goût n’était pas toujours la priorité : l’étonnement primait parfois sur le plaisir.
Cette cuisine recherchée témoignait du rôle social de l’alimentation. Elle ne nourrissait pas seulement : elle impressionnait, distinguait, créait du lien entre puissants. Manger devenait un spectacle.
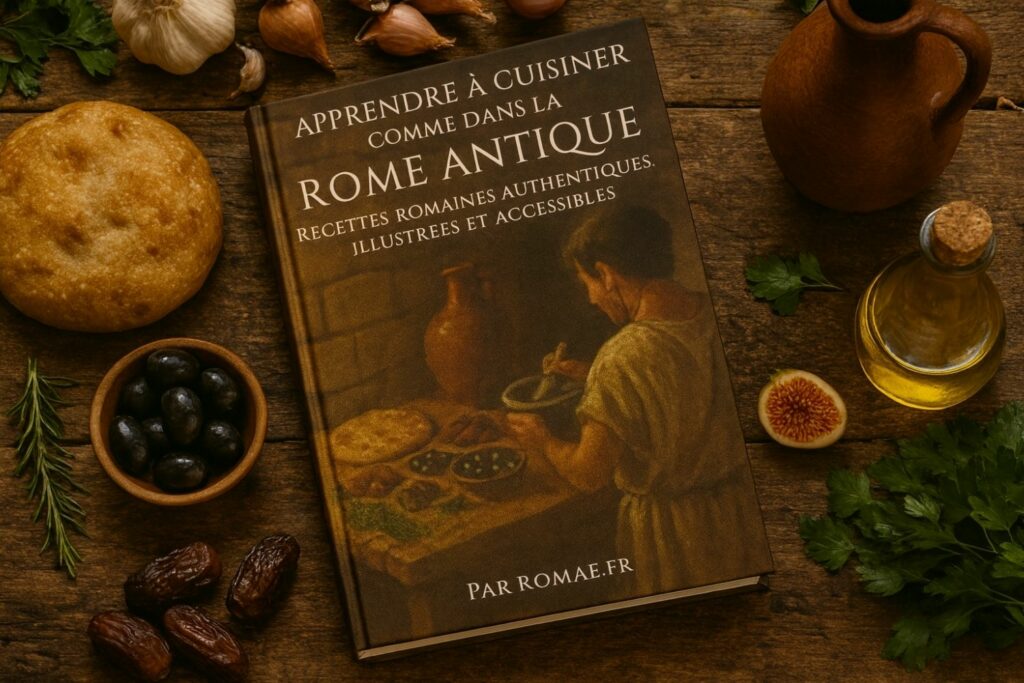
Des banquets composés de plusieurs services
Les banquets romains suivaient un ordre précis. Ils commençaient souvent par des gustatio (hors-d’œuvres), suivaient ensuite les mensae primae (plats principaux), puis les mensae secundae (desserts). Ce rythme structuré participait à l’élégance du repas.
On y trouvait une alternance de plats chauds et froids, sucrés et salés, dans une profusion étonnante. Chaque service était conçu pour surprendre les convives, tant par les saveurs que par la mise en scène. Le banquet était une performance culinaire.
Les hôtes rivalisaient d’audace pour proposer des plats nouveaux ou spectaculaires. Le raffinement touchait aussi la vaisselle, les nappes, les musiciens ou encore les parfums diffusés dans la salle.
Une grande diversité de viandes et de poissons
Les tables des riches regorgeaient de viandes variées : porc, bœuf, gibier, volaille, mais aussi sanglier, cygne, voire autruche. La chasse était un loisir noble, et son fruit, une source de fierté à table. Les viandes étaient souvent marinées, farcies ou rôties avec soin.
Le poisson était également très prisé, surtout les espèces rares comme le murène, ou les produits de la mer fraîchement pêchés. On appréciait aussi le garum de luxe, réalisé à partir de poissons nobles.
Cette abondance montrait la puissance économique du maître des lieux. La richesse se mesurait aussi à la diversité des mets, au nombre de convives et à la longueur du repas.
Quelle était la place des épices et condiments ?

Comment les Romains assaisonnaient-ils leurs plats ? Quelle importance donnaient-ils au goût et à la complexité des saveurs ?
Dans cette partie, vous verrez que la cuisine romaine savait être subtile et audacieuse.
Les Romains ne se contentaient pas de bouillir des légumes : ils raffinaient leurs plats avec art.
Entre sauces fermentées et herbes fraîches, leur cuisine méritait déjà le titre de gastronomie.
Le garum, sauce fermentée incontournable
Le garum était une sauce à base de poissons fermentés, véritable star des condiments romains. Fabriqué dans de grandes cuves, il nécessitait plusieurs semaines de macération au soleil. Le résultat : un liquide ambré très salé, riche en umami, utilisé pour relever tous types de plats.
On l’ajoutait aux soupes, aux viandes, aux légumes, voire aux desserts. Le garum existait en plusieurs qualités, les meilleures étant réservées aux riches. C’était un produit à la fois alimentaire et commercial, exporté dans tout l’Empire.
Son odeur forte pouvait rebuter, mais les Romains l’adoraient. Le garum symbolise leur goût pour les saveurs puissantes et complexes, bien loin de la simplicité que l’on imagine souvent.
L’usage d’herbes et d’aromates
Les Romains utilisaient de nombreuses herbes pour parfumer leurs plats : coriandre, thym, origan, menthe, laurier… Les jardins romains regorgeaient de plantes aromatiques cultivées à domicile ou achetées au marché. Elles accompagnaient aussi bien les viandes que les sauces ou les légumes.
L’usage des herbes n’était pas seulement gustatif. Certaines étaient censées favoriser la digestion, d’autres avaient des vertus médicinales. Ce lien entre cuisine et santé était très présent dans la mentalité romaine.
Les condiments tels que le vinaigre, le miel, la moutarde ou le silphium (aujourd’hui disparu) complétaient cette palette aromatique. La cuisine romaine s’apparentait ainsi à un véritable art des équilibres.
Des recettes souvent très relevées
Les recettes romaines, telles que transmises par Apicius, montrent une passion pour les mélanges forts. Sucré-salé, aigre-doux, épicé-acide : les combinaisons étonnantes étaient courantes. Loin d’être fades, les plats romains cherchaient à titiller les sens.
Les sauces étaient souvent épaisses, à base de vin, miel, vinaigre et garum. On y ajoutait des épices rares comme le safran ou le poivre noir, pour en faire des créations aussi complexes qu’élaborées. Certains plats comportaient jusqu’à dix ingrédients différents.
Cette richesse aromatique faisait la fierté des cuisiniers romains. Ils étaient souvent esclaves spécialisés, formés pour ravir les palais les plus exigeants. La cuisine était un terrain d’invention permanent.
Comment les repas étaient-ils structurés ?
À quel moment de la journée mangeait-on dans la Rome antique ? Quels étaient les rythmes et les rituels des repas ?
Découvrons maintenant l’organisation typique d’une journée alimentaire dans l’Empire. Vous verrez que leur rythme n’était pas si éloigné du nôtre, avec quelques différences étonnantes.
Le « jentaculum », petit-déjeuner léger
Le jentaculum était le premier repas de la journée, pris au lever du soleil. Il était souvent léger, composé de pain trempé dans du vin ou de l’eau, accompagné parfois de fromage, de dattes ou de restes de la veille. Les enfants, les travailleurs et les soldats le prenaient avant de commencer leur journée.
Ce repas n’était pas systématique chez les riches, qui préféraient attendre le déjeuner. Chez les plus modestes, il représentait une source d’énergie indispensable pour commencer une journée souvent physique.
Simple, rapide, peu varié, le jentaculum répondait à un besoin de praticité plus qu’à une tradition gustative. Il posait la première pierre d’une journée bien rythmée.
Le « prandium », repas de midi rapide
Le prandium était le repas de midi, souvent pris à la va-vite. Il s’agissait d’un encas plus que d’un véritable déjeuner, composé de pain, de fromage, de fruits secs ou d’un œuf dur. Les travailleurs le prenaient à l’extérieur, parfois en marchant, ou dans des auberges pour se restaurer rapidement.
Ce repas n’avait pas vocation à être long ni copieux. Il s’agissait d’un moment de pause, utilitaire, en attendant le vrai repas du soir. Les riches, eux, le prenaient parfois sous forme de collation ou le sautaient entièrement.
Le prandium rappelle l’importance du dîner dans la culture romaine. Il ne fallait pas se rassasier avant la grande « cena », moment central de la journée.
La « cena », dîner principal souvent copieux
La cena était le repas principal, pris en fin d’après-midi ou en début de soirée. C’est là que les familles se retrouvaient, que les affaires se concluaient, et que les invités étaient conviés. Pour les riches, il s’agissait d’un événement à part entière, souvent accompagné de musique ou de divertissements.
Les plats étaient nombreux, servis en plusieurs temps, avec des mets variés selon les moyens. Chez les modestes, la cena restait simple mais consistante, avec une soupe ou un ragoût copieux. Chez les riches, elle pouvait durer des heures.
Ce repas structurant, rituel et parfois spectaculaire, clôturait la journée romaine sur une note de convivialité, de plaisir et de partage.


Laisser un commentaire